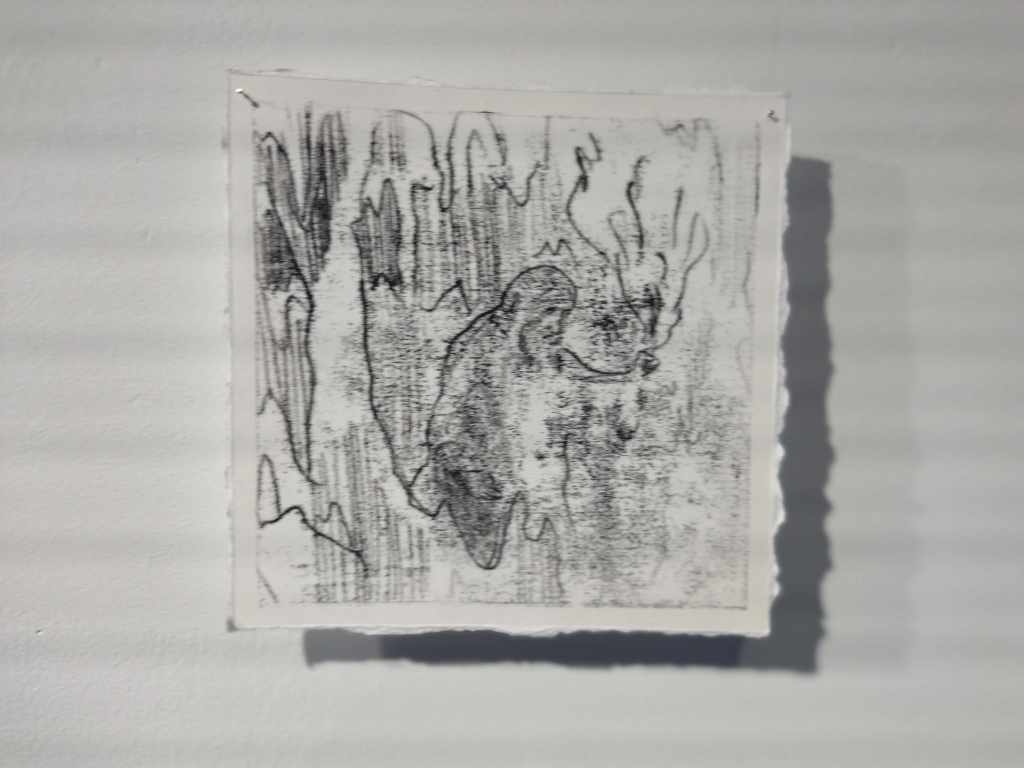Fil narratif à partir de : Beethoven, quinzième quatuor à cordes, troisième mouvement – Guillaume Le Blanc, Oser pleurer, Albin Michel 20024 – Sayre Gomez, Heaven ‘N’ Earth, galerie Xavier Hufkens

Du mal aux larmes, une naissance encordé aux pertes, les siennes, les autres, toutes les pertes
La première fois qu’il pleure ce long mouvement du quinzième quatuor à cordes de Beethoven, il est novice, vierge. Surpris. D’où viennent ces larmes ? Quelle source ? Il a bien déjà été marqué, creusé, raviné par une perte énorme, inexplicable, celle de sa mère, trop jeune elle aussi. En plein printemps, pleine adolescence, la mort de plein fouet, sans rien comprendre, secoué. Explosion de larmes irrépressibles. Quelque chose, au cœur de sa vie, désintégré en plein vol, perdu, soudainement. Quoi, comment ? Rien, on ne parle pas de ça, la vie doit suivre son cours. Ca va passer, ce n’est pas un mal qui ne s’empare que de toi, il est partout, il frappe ici ou là, ça vient ça va, faut faire avec. Il découvre donc que la vie peut faire mal à tout moment et que finalement, il ne contrôle rien, il n’a aucune espèce de souveraineté sur son petit territoire de vie, aucun moyen d’échapper à cet inévitable « mal de la perte inconsolable, mal de l’absence intolérable », incontournable acte de naissance, livraison d’une composante importante du devenir de tout un chacun. Impossible de vivre sans pertes. Dans la foulée, peut-être dans une dynamique de cause à effet, manière confuse de « faire son deuil », il intensifie ses visites à la Médiathèque, boulimie de musiques. Puis un jour, par hasard, les quatuors de Beethoven. Il emprunte le coffret de l’intégrale. (Attirance pour le prestige des coffrets substantiels, pour les « intégrales » et leur côté « savant », réservé aux connaisseurs, recherche de références culturelles à incorporer, capitaliser, pour se transformer, se distinguer, gagner de la valeur. Il ne souvient plus du nom de la formation. Quartetto Italiano ? Le Julliard ?) Il écoute scrupuleusement, plaque après plaque. Jour après jour. Appliqué, égaré, ennuyé. Et puis arrive le quinzième, le troisième mouvement. Il frémit. Il ne le sait pas encore, mais cela a à voir avec les larmes de sa mère, pour sa mère.
Quinzième, troisième mouvement, échos d’une intensité vitale terrassante
En descendant dans la matière lente de ce mouvement, comme on entre dans l’eau d’un fleuve, au fur et à mesure que la fluidité consistante des cordes l’imbibe, ému, égaré par l’émotion, il renoue avec ses premières vraies larmes, complètement irrépressibles, lâcher-prise total, et pressent qu’elles l’ont placé sur la trajectoire d’une histoire à venir, une poly-narration qui n’aura plus de fin, intime et poreuse à tout ce que charrie le flux des archets sur les cordes sensibles, depuis des siècles et des siècles, depuis que les larmes brillent dans l’histoire humaine. Il entrevoit, encore vaguement, qu’il y a quelque chose dans ces larmes, à récolter, à sanctuariser et à transformer. L’émotion musicale ne ravive pas uniquement l’instant tragique, passé, d’où jaillirent les larmes, il l’y entend revenir pour à jamais s’entremêler à celles des larmes futures, les siennes, mais aussi toutes celles autour de lui, au réseau hydrographiques de tous les pleurs à la surface de la terre, et cela donne du sens aux premiers sanglots, à la première collision frontale avec le néant. Il endosse confusément son statut de pleureur qui ne fera qu’évoluer au gré des coups et blessures, des catastrophes, des sinistres, des violences rencontrées, les siennes, intimes, et bien plus nombreuses, effroyables, celles de la marche du monde, notamment toutes les vies broyées par la politique migratoire de l’Europe. Il entend venir ça, à la manière dont l’ouïe des éléphants, hyper sensible aux « basses et très hautes fréquences », anticipe les catastrophes. « Dans la mesure où le sonore est une intensité excessive qui engendre les pleurs, ne peut-on pas dire, par un autre tour, que nous pleurons quand une intensité vitale nous terrasse et est quasiment insupportable ? » (p.248) Le troisième mouvement du quinzième quatuor naissait et se déroulait, à son oreille, comme une émission sonore hors radars, des fréquences en principe pas captées par l’humain en situation normale, et qu’il lui était donné de recueillir selon un don momentané, une grâce particulière, une vitalité terrassante.
Passage musical entre larmes et pleurs, pertes et disparition, présence et absence. La métamorphose des larmes et le vertige prolongé de l’apparition, vers un état de grâce
Dans les premières mesures du troisième mouvement, il reconnaît l’humeur qui le baigne, et qu’il refusait de nommer, une stagnation prostrée, ankylose dépressive des forces vives. Une traîne épurée, un souffle minimal. Une tresse rauque, sans voix, de perte inconsolable et d’absence intolérable. Et ça l’accroche d’emblée, d’entendre exprimé par les musiciens, spiritualisé, son climat affectif, éploré, refoulé. C’est, transformé en phrase encordée, abstraite, le recueillement désespéré tentant d’amortir, jadis, le fracas des larmes. Puis en avançant, le mouvement s’éclaire faiblement, une lueur se maintient, s’intensifie, certains événements surgissent, irruption d’énergie improbable, à partir de rien, du néant, précisément, et il suit, le mouvement le guide, il mime ce qui se passe dans la musique, ça le met en marche vers un usage inattendu des larmes, une alchimie qui fait qu’elles deviennent aussi la possibilité d’une autre vie, une autre forme d’amour du vivant. Là où il croyait avoir perdu le don de chanter, il muse, les filaments d’une chanson fragile s’ébauchent, remuent, tissent le fantôme d’une mélodie dépouillée. « Dans cette durée dilatée des larmes survient en nous cela même qui les efface et les rend invisibles : non pas que leur sensibilité ait disparu, mais elle est recomposée dans une allure de vie entièrement neuve rendue possible par l’avant-goût effrayant du néant. Les larmes ne sont jamais la mort de l’amour mais la pluie qui le nettoie et le rend possible sous une autre forme. » (p.62) Musique de passage, d’un col brumeux entre tourments et réconforts, hiver et été, la canzona du quinzième quatuor se présente à lui en maillage d’amour et de néant, une ligne de crête entre effondrement et état de grâce, tracée, ténue et têtue, par les violons, l’alto et le violoncelle, solidaires. Il revit le flux de ses larmes en un bonheur paradoxal, douloureux autant qu’inespéré, celui de retrouvailles, dans les tréfonds, avec ce qu’il croyait avoir perdu. « Désormais, je sais que je pourrai renouer avec ce que j’ai perdu, dans ce mouvement de ce quatuor ». Et dans la relation avec toutes les œuvres où situations esthétiques de même famille que ce mouvement de quatuor à cordes. Ce qui allait fortement orienter son penchant pour l’art, recherchant autant les expériences esthétiques continuant cette première effusion de larmes que celles apportant, en réponse, les éléments d’une vie autre, régénérée, nouvelle. Ce qu’il était bien incapable de formuler à l’époque, c’est qu’en ayant dorénavant en tête cette musique de Beethoven, il se trouvait doté d’une matrice narrative et poétique pour, peu à peu, transformer la perte en disparition, faire l’apprentissage des pleurs comme « métamorphose des larmes » qui maintient « le disparu dans le vertige prolongé de l’apparition ». L’apprentissage de l’absence présente, de la vie s’accommodant du mal inconsolable. « Tandis que dans l’épreuve de la perte le survivant se consume et se perd dans les larmes, la disparition est une recomposition de la vie avec les pleurs. Les larmes sont l’impossible à réprimer ; brusquement, toute intentionnalité est suspendue, seul advient leur mouvement irrésistible. Les pleurs sont une autre affaire, un pli dans la vie où se côtoient au plus près la présence et l’absence, la vie et la mort. Les larmes surgissent comme l’absolument irrépressible alors que les pleurs métamorphosent la vie en vie précaire. » (p.36) Canzona di ringraziamento offerta alla divinità da un quarito, in modo lidico (molto adagio) – Sentendo nuova forza (Andante).
Larmes et empathie. Par les pleurs, l’autre entre nous. Pleurs et écriture la nuit.
Irrigué par les larmes – autant les siennes que celles qu’épanchent tout humain frappé du mal de vivre (perte, injustice, maladie, violence) -, c’est la sève de l’empathie qui perle en lui, y trace un chemin. Un fluide le parcourt, tantôt en surface, tantôt dans les profondeurs, qui estompe les frontières entre intérieur et extérieur, et transforme en argile le socle de toute maîtrise. Touché par les larmes de sa mère, pour sa mère – pleurant sa mort, il avait l’impression que les larmes étaient la dernière chose transmise par elle, un legs ultime, littéralement expirant en larmes entre ses bras – , il acquiert peu à peu la capacité d’être touché par les autres. « (…) Pour se laisser toucher par autrui, encore faut-il perdre l’illusion d’une maîtrise totale de sa vie et reconnaître que les frontières entre les existences sont poreuses. Si nous sommes à ce point sensible que nous sommes émus par l’autre, au point de nous mettre en mouvement vers lui, de nous transporter jusqu’à lui, c’est que, certes, nous ne sommes pas lui mais qu’il est à ce point entré en nous que nous ne pouvons imaginer notre vie sans imaginer la sienne. » (p.191) Le réseau des larmes, dans l’histoire, à la surface de la planète, canalise l’impuissance solitaire face au destin et la transforme en force revendicative, solidaire, énonçant l’injustice, appelant justice, explorant sans cesse de nouvelles voies pour réparer, soigner, améliorer la société, exactement de la même manière que l’eau, dans la nature, cherche à s’écouler coûte que coûte. C’est une ressource, un liquide protecteur, un fluide qui porte. Et cela a à voir avec son penchant à écrire, écrire, sans cesse écrire, pour rien, la fenêtre ouverte. « L’hiver depuis des années, déjà. Mais il y eut de vrais étés. Peu de sommeil. Longues journées. Écrire la nuit, à trois heures du matin, toutes fenêtres ouvertes et l’air d’été venu des prairies et des champs de blé, jusqu’ici, jusqu’à nous, en ville, et jusqu’à moi, dans la chambre. L’écrire aussitôt dans le livre ! L’air d’été. Si léger, sent si bon. » (p.152) Écrire, pleurer, expier, panser, renaître. Tamiser la nuit espérant récolter des particules de la canzona de Beethoven
Le cloud extractiviste. L’émeute et l’entropie. Le précaire, nouvelles ruines mélancoliques du l’hyper-capitalisme. Rivages et dépotoir ultime.
D’où le choc devant les toiles de Sayre Gomez, braquées sur un monde sans larmes. Non pas libéré des raisons de pleurer. Mais où la capacité de pleurer, selon un « ordre venu d’en haut », fait l’objet d’un apartheid systématique, négation des pertes, des douleurs, des afflictions et mutilations. Invisibilisation redoutable de tous les êtres de peu de valeur marchande, en marge, désaffiliés, exclus du capitalisme, chair à canon de la croissance. Ce qui règne dans ces images vides, c’est l’âme damnée d’un système qui juge inutile de s’émouvoir de la désolation et la dépossession qui broient les fragiles, au quotidien. Ceux et celles chez qui, dès lors, les pleurs se transforment en rage impuissante, totalement impuissante, stérile, auto-destructrice.
Le frappe d’emblée une méta-image, avec à l’avant-plan une effrayante plate-forme d’extractivisme, en lévitation dans le cloud, transcendance de l’emprise industrielle sur tout ce qui touche au vivant, avec en arrière-plan et contrebas, une vaste étendue urbaine, artificialisation triomphante du globe, avec son bouquet puissant de gratte-ciels décisionnels, et au-delà, le sommet du cratère, l’infini minéralisé, dévitalisé, des flancs de montagne dénudés par l’exploitation (peut-être massif montagneux factice, reconstitué).
D’autres toiles hyper-réalistes, hallucinées, saisissent des restes de révolte, les signes d’une émeute dispersée – ou tombée d’elle-même dans une forme d’entropie radicale, soudainement dépourvue de sens, d’espérance – , caddies renversés en pleine flambée sur macadam, feux de circulation culbutés ; poubelle gorgée de déchets de fast-food, fondue par un départ de feu, en gros-plan devant un coin de banlieue calme, quelconque, avec vaste ciel orangé parcouru de nuages captant les reflets du soleil ou les lueurs et fumées d’un brasier pas très éloigné. Sayre Gomez peint aussi les abris précaires posés sur les trottoirs, les modes d’existence provisoires devenus permanents, dans la débouille et la récupération de déchets et rebuts. Survivre à ciel ouvert dans les détritus, l’œil sec.
Sur du sable fin, face aux flots où se reflète l’éclaircie solaire trouant un ciel gris, des contreforts de débris, amoncellement sinistre de pièces détachées de la société de consommation, en vrac, dépotoir rejeté par les flots, retour à l’expéditeur, l’ensemble évoque les châteaux de sable, enclos chimérique où réinventer une vie, à partir des moignons d’une vaste machine morte, mécaniques concassées, électro-ménagers périmés, caddies, parasol coloré au sommet des scories indiquant que, là, trône un marginal, bricoleur de ferrailles déclassées. Des flots marins ne jaillira plus le début de la vie, ni même l’incomparable vénus. Cette marine sordide ressemble à un cul-de-sac métaphysique irrémédiable.
Engendrer l’inhumain
L’accumulation des images sordides balaie froidement les dégâts du capitalisme, sonde ses entrailles malades. L’immensité affolante de tout le laissé pour compte, ce qui n’a plus aucun intérêt. Toutes les vies abîmées, dépouillées, dont les multiples deuils, incommensurables, restent en suspens, sans valeur, sans reconnaissance, niés, refusés, objets d’une déshumanisation systémique, routinière. Il émane de ces scènes d’une apocalypse en cours, lente et inexorable, une impression de mélancolie foudroyante.
Voilà les décors où les fragiles voient leur vie à jamais perdue. La « réceptivité de la souffrance de l’autre », comprendre ceux et celles qui n’ont pas pu réussir dans l’écosystème néo-libéral, y est proscrite. Premier et principal engrenage d’aliénation. « Plus fondamentalement encore, ne pas répondre à l’annihilation des conditions de réceptivité de la vie perdue en ne répondant pas aux pleurs qui font vivre la perte jusque dans l’imploration, c’est à la fois déshumaniser la perte (le sujet perdu), les pleurs (le sujet pleurant la perte) et la société qui refuse de répondre à ses pleurs, de les reprendre en son sein, de les entendre. C’est alors, à proprement parlé, engendrer l’inhumain. Car ne pas répondre aux pleurs de l’autre, c’est refuser de se laisser traverser par les affects de l’autre et ainsi d’engager sa vie dans la vie des autres. » (p.212) Dans les toiles de Sayre Gomez, il n’y a plus d’autres. Privés de larmes, de pleurs, ils se terrent, ne sont plus que des fantômes (absents des toiles). « (…) la négation du travail de deuil du pleureur, engendrée par la formation politique et sociale dominante, crée tout un complexe mélancolique dans lequel le deuil n’est tout simplement pas pris en considération en étant rendu totalement invisible. Il faut insister ici sur le fait que la mélancolie n’est précisément pas le fait du pleureur mais est bien engendrée au contraire par la formation sociale et politique hégémonique qui s’exerce dans le dos du pleureur en le niant. La mélancolie est alors une hallucination de la formation sociale hégémonique. » (p.224) La mélancolie a pétrifié, englouti la civilisation peinte par l’artiste. Rien ni personne n’y a résisté.
Choisir son camp ?
Mais de quel côté est le peintre ? Ces toiles ne pleurent pas, ni lamentation ni rage, ni offuscation, elles ne fustigent pas l’injustice, parées d’une certaine esthétique clinique, froide. Cynique ? En miroir ? Il y a dans les couleurs une certaine taie blanchâtre qui évoque, peut-être, une empathie refoulée, figée. Un effroi paralysé ? Juste un voile. Quand on regarde le lieu dans lequel ces toiles sont montrées, riche et aseptisé, galerie-bunker-coffre-fort du marché de l’art, on pourrait même soupçonner qu’exhiber ce savoir-faire artistique dédié à la représentation de la misère de l’effondrement, aux sinistrés mélancoliques privés de tout, à la perte de tout espoir de paradis sur terre, est juste là pour émoustiller les amateur-trices bien nantis, leur donner le vertige d’une puissance face au monde écrasé, privé du sensible qu’ils accaparent et cultivent quant à eux dans leurs collections, leurs achats et expositions, leurs célébrations-vernissages. Que signifie acheter à prix non négligeable une toile représentant les dégâts morbides, à grande échelle, du totalitarisme néo-libéral ? Achète-t-on ce genre de peinture parce qu’on trouve ça « beau » ? Va-t-on accrocher ça dans son salon pour sensibiliser les invité-e-es, à l’occasion, et suggérer la nécessité de changer de modèle de société ? Ou est-ce réservé pour des musées soucieux de thématiques sociétales, musées fréquentés par des minorités éclairées ? Une partie de l’argent généré par cet art est-il versé à des organisations, des associations, des réseaux qui luttent contre la mélancolie totalitaire, « hallucination de la formation sociale hégémonique », proposant des formes de guérison !?
Pierre Hemptinne