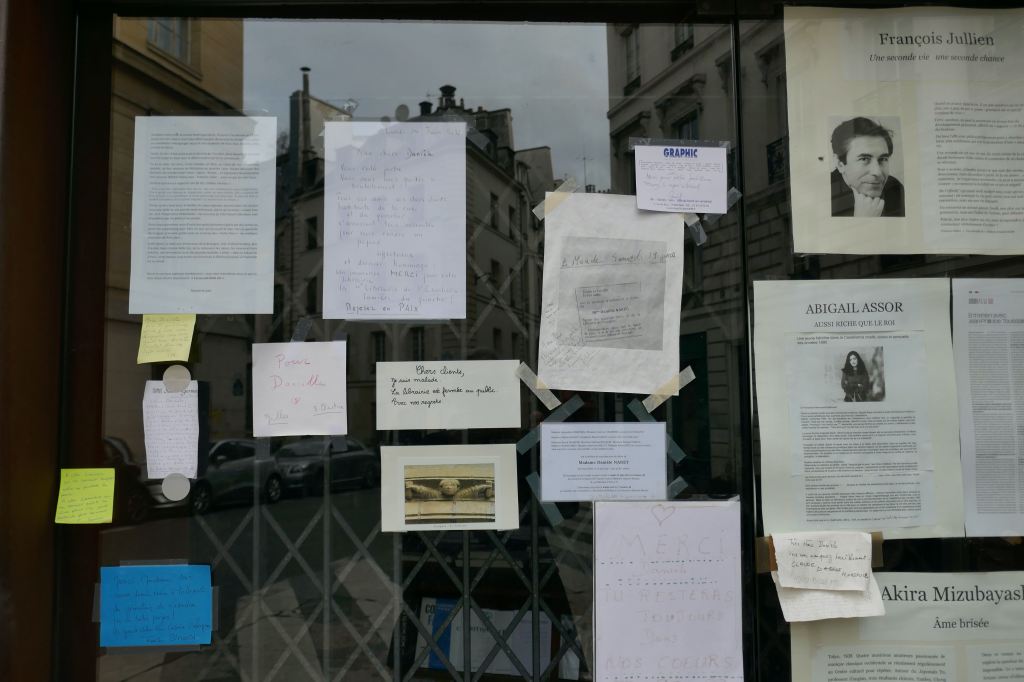Fil narratif à partir de : Miriam Cahn, « Ma pensée sérielle », Palais de Tokyo – Georges Didi-Huberman, « Brouillards de peines et de désirs », Minuit 2023 – Baptiste Morizot, « L’inexploré » Wildproject 2023 – diverses bactéries…

Il pressent un cheval de Troie bactérien dans un de ses organe. Il ne sait pas encore précisément lequel. Cet organe et l’envahisseur bactérien, d’une certaine façon, bon ménage, façonnent un écosystème qui convient à leur union et rêvent de coloniser tout l’organisme, par le sang. C’est une présence sans nom, – plutôt une métamorphose impensée de soi –, tant qu’aucune analyse médicale ne vient identifier l’intrus. En tout cas, cela bouleverse ses affects à fleur de peau. Les déracine, les chahute, les déporte. Un brouillard imbibe l’épiderme, égare les notions d’intérieur et d’extérieur, d’ici et là-bas. D’abord rien d’autre qu’une fièvre de chien. Rejet intense de toxines. Pourtant, le tonus global est optimiste, il s’exalte même. Peut-être est-ce une exaltation de possession, dopé qu’il est de se sentir élu par des visiteurs-teuses venues d’ailleurs, étrangères, générant une vague d’énergie surnaturelle qu’il croit d’abord pouvoir domestiquer, et par là augmenter sa puissance, avant de douter, suspecter lentement mais sûrement que cette force intrusive se substitue à sa vitalité propre, purement et simplement. La remplacer, la transformer en quelque chose de tout autre. Ce qu’il ne voit même pas vraiment poindre d’un mauvais œil. Plutôt intrigué. Suspens dont il est l’enjeu.
Plus d’enveloppes mais des frissons
Se promenant, des jeux de lumières et couleurs qui, d’ordinaire, l’émeuvent, le touchent – à chaque fois, « événements » neufs – ne lui font plus ni chaud ni froid, ils sont là, simplement. Ce n’est pas qu’il soit blasé. Il les voit sans les ressentir en lui. Sans les reproduire en lui, les sentir entrer en lui. Il se souvient de l’émotion que cela suscitait, un an avant, à la même époque (ce sont des jeux de lumière saisonniers, liés à l’état de la végétation naissante à cette période de l’année, aux luminosités typiques de ce passage de l’hiver au printemps). Là-bas, sur la ligne des labours, un saule d’un jaune juvénile, fébrile, à peine né, vif et vagissant sous le spot du soleil, transfiguré sur une nuée noire de giboulée orageuse, dont il recevra le grésil un peu plus tard. Plus exactement, il est pris dedans, il est fondu dedans. Il est l’extérieur qu’il regarde. Il ne ressent plus les choses depuis un intérieur à partir duquel établir une distance, une différence, prélude à la jouissance esthétique (où l’on reçoit de quelque chose/quelqu’un, où l’on donne à quelque chose/quelqu’un). La barrière-philtre s’est estompée ainsi que la porosité quelle organisait, la porosité étant aussi un mode d’échange, d’interrelation, de transit assumé entre les choses et soi.
Il n’a plus d’enveloppe, où qu’il soit, il a froid, sans cesse, il tremblote, il est parcouru de frissons, d’infimes vaguelettes lui hérissent le bas du dos (comme de sentir ses poils se dresser face au danger). Il est secoué, ses dents s’entrechoquent un peu, dès qu’il bouge, ou se déplace au jardin, se traîne un peu sur la route, dès qu’il change de position dans le fauteuil. Pour endiguer le gouffre des frissons – il lui semble qu’il pourrait y disparaître – il accumule les couches, chemisette en mérinos, chemise, pull, premier polaire, second polaire, robe de chambre, plaid. Rien n’y fait. Au moindre déplacement, il se découvre partiellement, le froid lui inflige comme une décharge électrique. A chaque miction maladive, intempestive, dans le seau qu’il garde près de lui, douloureuse et rougeâtre (« ah, ça recommence, faut que je me fasse conduire à la pharmacie, en bas »), il s’éparpille dans le dehors glacial, doit patienter de longues minutes avant de retrouver, sous ses multiples couches, une température stable, à lui. Il n’a plus besoin de penser, de lire, de commenter, il lui suffit de regarder ce qu’il a sous les yeux, sentir ce qu’il ressent. Le monde est le grouillement qui l’affecte.
C’est une sorte d’immédiateté tremblante, intranquille, qu’il doit aux invisibles bestioles qui le violentent, sans intention de nuire, du simple fait qu’elles existent et ont trouvé la porte d’entrée. Ce ressenti physiologique – où la singularité des faits de son histoire s’estompe, se dilue, plus rien n’étant retenu – exhume une imagerie baignée de teintes instables, pas abouties, pigments débiles et fébriles.
Racines et fosse commune
Flux de couleurs fraîches, d’une fraîcheur tuméfiée, rongée par un cancer omniprésent. Elles lui reviennentdes peintures de Miriam Cahn, vues il y a des années au Palais de Tokyo.
La silhouette soudainement illuminée d’un arbre, dressée comme une ampoule fragile, vaporeuse, sentinelle éphémère, presque sans attache, s’envolant, fuguant au ciel, échappée d’un lieu où l’on réprime les éclosions. Un autre arbre au feuillage pâle, s’évapore peu à peu dans une atmosphère indifférente, ses racines puisant une sève sanglante, une lave défoliante envahissant tronc et branchage. Le feuillage pâlit. Comment vivre, s’épanouir, quand ses racines plongent dans l’humus sanglant, absorbent le jus des innombrables mortes par violente, racines fouillant la fosse commune des féminicides ? Comment s’échapper et rester arbre ?
Il y a aussi cette vallée verdoyante, juste un halo gazeux, instable, un mirage au pied de montagnes à la neige grise, sillonnée d’une trainée rougeâtre, l’arête des pics sanglante, voilà, l’obstacle insurmontable, le cirque rocheux qui enferme et condamne tout espoir de passer de l’autre côté, d’atteindre le bleu, d’ailleurs si hautain, si idéal qu’il en est inhumain, menaçant, indésirable. L’image placée à côté : dans une atmosphère sombre, dense, cieux et terre opaques, ténébreuses, une maison transparente, refuge qui ne protège de rien.
Une image d’avance (comme on dit un temps d’avance)
Il se souvient avoir eu du mal à se fixer devant telle ou telle image. Cela bougeait. Ce qu’il devait saisir glissait de l’une à l’autre, le regard ne se posait pas, avait l’impression que le sens d’une image se trouvait dans la suivante, ou la précédente ou celle qui n’était pas encore là, en train de se faire. Un mouvement irrépressible à la fois vers la profondeur étouffante et vers un horizon où respirer, reprendre haleine. Cela tenait peut-être à la manière dont travaille l’artiste telle qu’elle l’évoque lors de diverses interventions dont un portrait publié par Libération (12/04/23) : « Tous les jours de toute la vie, l’incontournable plasticienne suisse se lève vers 11 heures, lit la presse internationale, puis réalise une œuvre à la beauté redoutable et la violence infinie. Trois heures maximum, qu’il s’agisse d’un petit dessin aux couleurs phosphorescentes ou d’une toile de cinq mètres à la craie noire. Jamais d’esquisse. Une fois l’œuvre terminée, elle la retourne contre le mur ou la roule dans un casier soigneusement numéroté, et ne la regardera plus. » C’est ce qui fait qu’aucune peinture n’est une œuvre en soi, avec un début et une fin, mais est le fragment d’une discipline, d’une pratique journalière, pour essayer de capter ce qui ne peut se fixer à l’intérieur d’un cadre statique. Ce qui compte est cette « routine » dans la quête d’images en prise avec le problème abyssal de la société, de la civilisation, celui de l’oppression des un-es par les autres, banale, innervant la tension sexuelle inscrite au cœur de la gouvernance du monde, depuis la nuit des temps, depuis l’organisation de la domination d’un sexe sur un autre. Au cœur d’un régime inégalitaire, la peur doit régner quelque part. Arrêter de produire les images qui ramènent à la surface les symptômes de cette malveillance systémique serait comme de n’avoir jamais dessiné ou peint le moindre tableau (ce n’est pas une thématique que l’on traite juste une fois, cela n’aurait pas de sens). Quelques petits écrans, dans l’exposition, révèlent le tempo inlassable, infatigable de cette dynamique répétitive, obsessionnelle, de montrer la contagion de la violence dans la formation de toute image du monde, petite ou grande, gangrène iconique.)
Couleurs stressées, porosité
Beaucoup de surfaces avec des couleurs qui n’en sont (presque) pas. Comme avortées, ou prématurées, sous l’effet d’une terreur soudaine, d’un trauma non seulement indéfinissable mais « normal », « banal ». Des couleurs sombres, inabouties, profondeurs mouvantes, entrailles telluriques. Ou à peine régurgitées, vives, à peine « posées », volatiles, un peu aigres, salies. Couleurs longtemps couvertes, encavées et qui suintent, vaguement éblouies, ne savent même plus qu’elles sont couleurs, nouées comme on parle de tripes noueuses dans l’angoisse et le stress de ce qui est advenu, de ce qui vient.
(Ce sont ces couleurs qui lui reviennent, fumées lointaines, brumes éparses, taches insistantes, vapeurs stagnantes, d’abord comme générées par son infection, comme si les bactéries faisaient circuler des fragments d’entrailles teintées à la façon des toiles de Miriam Cahn, réveillant des atmosphères, des formes, des scènes. Cela lui revient donc comme des croquis organiques, tapis dans la fibre même de son histoire, et que des courants imperceptibles d’humeurs débusquent, font bouger, s’élever, se répandre, s’échapper, s’évanouir, comme des nuages sur les parois d’une caverne. )
Un climat de violence permanente, pénétrante, étalée et cachée à la fois, avec les côtés fulgurants et hallucinants du passage à l’acte, explicite, cru, et les côtés aveugles, les agencements où s’installe le refus de voir, la résignation des victimes qui ne comprennent pas ce qui leur arrive, les épaisseurs psychiques qui encaissent, dépourvues, désemparées, éclatées, culpabilisées
D’étranges tableaux.
Un corps allongé, une dépouille nue, massive, usée, travaillée, malaxée. Décomposée, indistincte. S’il n’y avait un éclairage blafard sur les doigts de pied, sur le sommet chevelu blanc, s’il n’y avait, du flanc, une main livide qui s’extirpait, se désolidarisait, faisait mine de s’éloigner de la charogne étalée sur le dos, rouille et viande saignée, il n’aurait pas vraiment identifier cette silhouette abattue comme celle d’un corps humain. Perdu. Un corps oublié, que personne ne réclamera, impleurable (selon Judith Butler). Comme ces cadavres anonymes gisant dans la poussière des rues en guerre, sacs affaissés, abandonnés, aperçus lors de reportages télé. Exposé à l’abîme sur un catafalque de sable, de limons tourmentés, caressé par des linceuls fuligineuses dérivant au ciel, nuages lourdement cardés. Écrasé par un azur irascible lointain, inaccessible. Dépouille ambigüe, victime ou bourreau exécuté, martyr ou vengeance, n’importe, silhouette de mort violente au cœur des matières originelles du paysage, d’où partent les récits. Il y a là quelque chose qui pense par l’image en train de se faire – ce travail quotidien de l’artiste, bien régulé, structuré, discipliné, déclenche une pensée par l’image – , s’enchaînant à d’autres à venir, en gestation, et qui met en échec la volonté de savoir clairement, objectivement, avec des mots d’emblée à disposition, ce que l’on voit sur la toile. Il s’y est arrêté justement parce qu’il ne savait pas ce qu’il y avait, là, ce que ça montrait. « … une pensée par images qui, sans doute, permet de n’avoir pas à distinguer une fois pour toutes telle chose de telle autre, tel corps de tel autre, telle matière de telle autre » comme l’écrit Didi-Huberman. » (p.36) D’ouvrir ainsi des espaces de redéfinition des choses. Et le fait de buter dans l’incompréhension partielle face à ce qui est dessiné et peint, de n’avoir pas su ce que c’était, de ne le savoir toujours pas, l’entraîne dans une pensée labile, imagée, en tous sens. Et si au lieu d’un mort, d’un corps fini, achevant d’expirer tous ses fluides, toutes ses atmosphères psychiques s’exhalant peu à peu, il y avait là, bien plutôt une larve, un mort-chrysalide, en devenir (qui expliquerait que, de la masse vaporeuse avachie, surgisse une main déjà formée, des pieds qui ressemblent à des pieds, membres revenants) ? « Les matières sont dites indistinctes parce qu’elles sont pensées comme poreuses. Et elles ne sont si souvent poreuses que parce que domine en elles un principe dynamique de passages, d’écoulements, de transmissions liquides et, même, vaporeuses (en tant que métamorphoses et diffusions de liquides dans l’air ambiant). » (p.36) Ce corps, oui, infuse et diffuse, dans le limon, le nuageux, l’azur brut , engagé dans une transmission, trouble. Quelque chose de tabou. (Genre le géant/maître mort qui continue à inspirer la peur).
Des images distillent le malaise.
Tapis volant sur abîme violent
Deux êtres couchés sur la même couche, à distance l’un de l’autre, repoussés. Tétanisés, l’un par la menace ou l’attaque subie. L’autre par l’agression perpétrée ou la jouissance prise à soumettre l’autre, violenter par nature. Le corps mâle est grand. Le corps femelle est petit. Cela ne signifie pas qu’il y ait un adulte et un enfant (comme auraient tendance à le croire des citoyen-nes d’extrême droit qui ont accusé l’artiste de pédopornographie, comme l’a cru l’ancien élu RN qui a finalement vandalisé l’œuvre, dans un besoin malsain de trophée muséal, où implanter leurs idées violentes).Dans leur immobilité, ils sont entourés des gestes fantômes qui viennent d’avoir lieu ou qui vont se décharger. Du côté mâle, ce sont des secousses qui démultiplient l’appareil musculaire, hydre redoutable. Du côté femelle, ce sont des défaillances spectrales qui liquéfient et amputent les membres, paralysent. Le drap sur lequel ils gisent est imprégné des humeurs aigres, avariées qu’exsudent les corps dans la possession forcée (« tiens, ça ressemble aux teintes de mes urines épaisses et rouges, avant l’oxydation », se dit-il). Mais ce qui l’avait surtout frappé est que ce drap ne recouvre pas le matelas d’un lit, d’une couche ordinaire, il semble flotter, légèrement transparent et, de part et d’autre, sa surface laisse apparaître, le vide, le ciel, révélant une situation aérienne, celle d’un tapis volant. Le conte de fée vire au cauchemar. Ce grand tableau est jouxté par un dessin plus petit, portrait funéraire du mâle tourmenté sur sa couche, et un autre, placé plus haut, lucarne où se pourlèche un hybride mammifère-oiseau, repus de sang.
(Sanguinolence qui le renvoie une fois de plus à ces urines, accumulées dans le seau, rougeâtres, brunâtres, jaunasses, fétides. La fatigue le gagne, houle irrésistible, amplifiant le désir de replis, de cocon, de multi-couches. Mirage d’un repos illimité. Le sang dans l’urine évoque une confusion des canaux intérieurs, plus rien n’est séparé, une confusion règne. Une métamorphose intérieure faite de passages, d’écoulements, de transmissions liquides et, même, vaporeuses. L’hybridité le gagne. Bien que tassé dans son fauteuil, engoncé sous les couvertures, la peau humide de suées, il ne tient plus en place, métaphoriquement, le vague à l’âme lui donne le tournis. Le cœur n’est plus à sa place, devenu entité vaporeuse qu’il partage avec les bactéries qui l’envahissent… il se sent glisser vers des fonds inconnus, c’est pas désagréable, malgré une menace sournoise qui s’insinue, retrouvera-t-il, quelque part, son « je », ou est-ce déjà trop tard ?
« Si je ne peux descendre au village, téléphoner au pharmacien, qu’il me monde des antibiotiques… je ne passerai pas commande par PharmAmazone… négocier les antibiotiques, sans prescription, ffft… »
Situation métamorphique, protéiforme
Fièvre aidant, l’exaltation latente s’obstine à vivre, à l’échelle personnelle, une aventure universelle, passionnante, selon laquelle « l’évolution des lignées de vivants passe par une chimérisation lors de laquelle des espèces différentes entrent en symbiose pour produire de nouvelles formes de vie. » (p.30) Se sentir le siège d’émergence possible d’une nouvelle forme de vie, ça intrigue, ça excite ! Dans la confusion, il est envahi par des temps anciens, primordiaux, résurgences des débuts immémoriaux (ceux-là sur lesquels la civilisation occidentale a voulu établir sa propriété), carrément, où les forces mythiques décidaient de la forme du monde que l’humain allait explorer et bâtir, « le moment où les êtres de la métamorphose prolifèrent », avant l’assignation de quelque statut que ce soit. C’est, en quelque sorte, le retour en lui d’un pareil « temps mythique ». Qu’est-ce, à vrai dire ? « Or, si l’on se souvient du temps mythique tel qu’il est décrit dans les ouvrages d’anthropologie, en première approximation, il s’agit d’un temps d’avant le temps, dans lequel les êtres sont encore indistincts. Les formes de vie ne sont pas encore séparées. Les animaux ne sont pas encore distincts des humains. C’est une situation métamorphique, protéiforme. Une situation dans laquelle les êtres ne sont pas encore individués. Et conséquemment, on n’a pas encore de statut précis à leur donner, et surtout, les relations qu’on entretient avec eux ne sont pas encore stabilisées. On ne sait pas quels rapports on peut entretenir avec eux.» (p.31) Déstabilisé, gagné par une constitution floue, protéiforme, sans plus aucune distinction entre lui et ses hôtes bactériens, glissant d’un côté vers la fin et, de l’autre, vers un renouveau inédit. Au fur et à mesure, tout de même, affecté par l’affaiblissement, c’est surtout la peur qui le gagne. Plus le temps passe, jouant en faveur de l’envahisseur, ses défenses immunitaires s’avouent peu à peu vaincues – réalisme qui ne se dit pas encore tel quel à la conscience -, il pressent sa défaite. Quel est le degré de métamorphisme qu’un organisme peut supporter sans passer de l’autre côté du réel qui était le sien jusqu’alors ? Et c’est exactement cette peur spongieuse qui crée une familiarité aigue avec les couleurs et les images de Miriam Cahn, lui permettant de les comprendre mieux que jamais. (Alors qu’il en est à chercher la sortie de secours, « si je descends au bistrot du hameau, je trouverai sûrement de l’aide, on me conduira chez un toubib, à l’hôpital ? … Téléphoner à mon ancien docteur pour une ordonnance urgente ? Se souvient-il de moi ? … parlementer sera épuisant, trop… Ne reste-t-il pas quelques médicaments, dans une caisse, mais laquelle, où ? … pas la force d’entreprendre des recherches » … Avant d’être gagné par une nouvelle phase de calme lucide où ressasser les couleurs et images de Miriam Chan, s’en souvenir du mieux possible, l’aide, au fond, à se préserver.)
Chute et Nativité
La chute. Une femme, un enfant. Nus, éprouvés. La femme n’a pas l’apparat souple et romantique, morbide triomphant, d’Ophélie. C’est un corps usagé (dans le sens « on en a fait usage, sans ménagement »). Le cou est translucide, la tête presque détachée. Les yeux clos. Pourtant, il n’est pas certain qu’elle soit morte. Le bébé n’a rien d’un nouveau-né tout lisse, tout neuf, innocent. Lui aussi semble déjà avoir dégusté. Entrejambe rougeâtre. Deux être jetables. Sombrent-il dans les abysses aquatiques et ce que l’on voit qui les surplombe, est-ce la surface de l’eau, irisée de taches, trace de sang, luminescence verte qui expire. Souvenirs de palpitations. Ou bien sont-ils expulsés du ciel et tombent-ils dans la nuit sans fin ? La texture qui les entoure, bleue orageuse, chargée, a quelque chose de cosmique, d’aurore boréale brouillée, c’est une chute sans fin dans l’espace, c’est une sorte de chute violente initiale, la première, comme à l’origine du monde, une sorte de big-bang, depuis toujours, ces corps jetables initiaux, paradigmatiques, chutent, ne cessent d’inventer le vertige, d’ouvrir la voie vers l’abîme inimaginable. Une nativité inversée. Mélange de glauque et de féérie qui prend à la gorge, fait tourner aigre toute une tradition de jolies images sur la Vierge et l’enfant (par exemple). En haut à droite, une toile plus petite, un insomniaque livide, nu, sur fond printanier barbouillé, exerce sa vision latérale, exorbitée, tente de surprendre la présence indéfinissable qui ne cesse de le suivre, comme son ombre, qui lui pèse telle une menace. Âme pas tranquille.
Lisière de vitalités salvatrices
N’empêche que, dans le mouvement qui le poussait d’une image à l’autre, dans le vaste espace – trop grand – du Palais de Tokyo, cherchant dans la répétition de la rencontre avec une image nouvelle, le sens arrêté, du moins complété, de cette peinture en train de se faire, ce qui l’avait marqué était l’affirmation d’une vitalité malgré tout, et la volonté de chercher comment donner à cette vitalité la force d’une libération. Un imagier de la vitalité malgré tout. A la manière dont Achille Mbembé explique que les savoirs accumulés par les êtres persécutés sont ceux-là même dont le monde a besoin pour trouver des solutions face au désastre climatique (dont est responsable l’homme blanc extractiviste, porté par l’ontologie naturaliste, celui-là même dont Miriam Cahn peint l’essence violente, multiforme.)
“La vitalité en général ne devrait-elle pas, désormais, être pensée sous l’angle d’un devenir et d’un sortir, toujours à reconduire, à réactiver, à redanser ? C’est-à-dire d’un émouvoir et d’un réémouvoir capables de fragiliser toutes nos assises, de déplacer toutes nos stases, de critiquer tous nos jugements ? Ne devrions-nous pas sortir en permanence, c’est-à-dire renaître à chaque fois ? » (Didi-Huberman, p.468) N’est-il pas temps, en effet, de « fragiliser toutes les assises » du monde actuel, de sa violence systémique exercée à l’encontre des autres, des fragiles, des femmes ? N’est-il pas temps d’en finir, de « sortir », de « sortir en permanence » d’un système destructeur pour semer le réémouvoir désarmant, puissant, fait d’une multitude de renaissances, vécues par le plus grand nombre (comme on dit), un temps de grâce, un temps mythique pris en charge démocratiquement, avec un horizon égalitaire ? Oui, il avait bien pensé à quelque chose ainsi, il y a des années, en ruminant ce qu’il avait entrevu dans les toiles de Miriam Cahn (attaquée ensuite par l’extrême droite). Au-delà du sombre et du cru, il y avait entraperçu les lueurs d’une vitalité à venir, en tout cas, potentielle, dansante, encore atteignable, à l’époque où la peintre, chaque jour, peignait de telle à telle heure, telle un métronome d’espoir…
Pierre Hemptinne