Fil narratif à partir : Les enfants rouges, table parisienne – Frédéric Lordon, La condition anarchique,Seuil 2018 – Dolorès Prato, Bas la place y’a personne, Verdier 2018 – James C. Scott, Homo Domesticus. Une histoire profonde des premiers États, La Découverte 2019 – Olivier Beer, Households Gods, Galerie Thaddeus Ropac – Neige, des souvenirs, etc.
Plutôt que sans cesse courir les nouvelles tables de la compétition gastronomique, et se muer soi-même en compétiteur, revenir s’assoir à la même adresse, au même comptoir, sentir se tisser un lien entre le savoir-faire d’un cuisiner en particulier et l’attitude qu’il a – à la fois contemplative, tendue, intense, inquiète – devant l’assiette. Tout ce qui est disposé là, depuis le contenu de différentes casseroles , poêlons et autres appareils jusqu’à l’agencement minutieux, à la main, dans la vaisselle de service et l’exposition de l’assiette finie, nantie de son paysage, à l’appétit du convive, chaque fois une œuvre qui s’adresserait à lui singulièrement, presqu’une œuvre unique malgré la ressemblance avec d’autres assiettes en train de voyager depuis l’office vers les différentes tables, déclenche soudain des pensées, des parfums oubliés, des sensations diffuses, des souvenirs brefs et lumineux, des suggestions, des promesses. Quelque chose de fulgurant. Et de quelle manière, chaque fois bouleversante, comme un retour à un berceau des saveurs, sachant qu’il n’y a jamais naissance nette, mais progressive, sédimentée, mêlant des temporalités et des localisations différentes, des récits pluriels, hétérogènes. Mais le tout inscrit dans un continuum d’expériences passées et présentes dont les effets continuent leur lente propagation et décomposition. Et ce face à l’assiette, engageant le corps et l’esprit, à la façon dont les œuvres d’art expriment et communiquent leur puissance liante, reliante. « Le corps-esprit puissant est bien celui qui éprouve et pense beaucoup de choses à la fois (simul). A quoi alors pourrait-on mesurer la puissance d’une œuvre, et partant sa valeur, sa vraie valeur de puissance, indépendante des issues axiomachiques institutionnelles ou des véridictions douteuses ? A la manière dont elles induisent en nous plus de liaisons, dont elles nous aident à tenir plus de choses ensemble. » (p.234) Chaque assiette ici, avec ses couleurs, la configuration paysagiste des produits et leurs fumets conjugués est, par excellence, inductrice d’un plus de liaisons. Pas forcément explicites, mais à l’état brut, un concentré d’intuitions régénératrices, reconstituantes à tout le moins, et que l’on avale, avide.
Par le large passe-plat entre cuisine et salle, apercevoir quelqu’un. Pas tel ou tel concurrent d’un quelconque top chef. Mais, fidèle au poste, le même cuisinier, affairé, concentré, attentionné bien que nerveux, méditatif bien que sous pression, inchangé depuis des années, bien que toujours aussi neuf, à l’allure presque novice. Il ne prépare pas tel ou tel coup d’éclat, il est dans son continuum. S’émerveiller de lui voir conserver cette luminosité tout en reconnaissant que sa physionomie a gagné en maturité, en même temps que sa cuisine et la composition de ses plats. En effet, le fil rouge auquel il avait décidé de consacrer ses recherches, celui de revisiter les classiques de la cuisine de bistrot française, en sollicitant un héritage japonais, était au départ plutôt littéral, intuitif, classique avec quelques touches géniales, juste des ouvertures. Cet exercice continué jour après jour, sans doute poursuivi dans une stricte fidélité à l’intention première, presque comme on répète la même chose, au fil du temps s’est imperceptiblement éloigné de l’épure initiale et a incorporé, sans s’en rendre compte, une complexité raffinée inimaginable au début. Une complexité naturelle, qui coule de source, raffinée et qui, pour quelqu’un qui goûterait aujourd’hui pour la première fois les plats de ce chef, ne serait pas perceptible, parce qu’il ne mesurerait pas le chemin parcouru, la dérive méticuleuse, ingénieuse, fruit d’un approfondissement instinctif au cœur d’une même démarche, des mêmes gestes, d’un savoir-faire avec lequel il a construit les bases d’un style.
Avec le maquereau de Bretagne mi-cuit, avec sa salade pommes de terre, il retrouve une nourriture traditionnelle de bistrot, mais aussi un plat familial qu’il aimait partager avec son père, de filets de harengs marinés avec des pommes de terre froides assaisonnées de mayonnaise. Ici, l’interprétation recouvre et déborde l’original, convoque et sublime les saveurs connues et puis diffère complètement, ouvre des pistes vers une infinité de variations, de nuances, de conjonctions nouvelles, grâce à ce qu’il y associe, la sauce au vin blanc et au Mont d’Or remplace la mayonnaise, avec une finesse onctueuse, et surtout les algues et le boulgour en filaments croustillants et quelque fines tranches de kumquat qui, rouages fruités colorés, une fois sous la dent, font exploser la fraîcheur de toute la composition.
Déguster des yeux, des papilles, des narines, siroter, vider consciencieusement une bouteille de Beaujolais nature, vérifiant avoir une grande soif mais surtout en ruminant que c’est ici, dans ce lieu qu’il avait le plus ardemment souhaité venir dîner avec une amoureuse à présent disparue, dans la période des amours où il est si important de sortir, de s’attabler à des tables que l’on aime particulièrement, qui révèle nos aliments préférés et nos appétences tant organiques qu’immatérielles. Ici, elle aurait mieux compris à quel point elle irradiait tout un écosystème me nourrissant, dont j’ai besoin de dévorer les fruits, où je suis un éternel cueilleur chasseur.Il avait manigancé en de multiples occasions pour y parvenir, lançant des invitations loufoques, élucubrant des combines un peu scabreuses, et échouant de peu, le rendez-vous étant conclu une fois et décommandé à la dernière minute pour raison de santé. Écœuré, renonçant la mort dans l’âme à échafauder de nouvelles tentatives (les obstacles étaient nombreux, des vies séparées, des villes éloignées). Mais de l’avoir tant rêver, de s’y être vu avec elle tant de fois, mentalement, il a été ici avec elle sans y avoir jamais été, même mieux, ici, ils se retrouvaient régulièrement et parvenaient à une communion inégalée ailleurs.Et curieusement, d’y revenir, de préférence seul, pour se laisser sombrer dans le mutisme où il sait qu’avec patience et vigilance il parviendra à récupérer des vestiges de ces temps parallèles, le fait se sentir plus proche d’elle que de revoir n’importe quel autre endroit où ils ont été pourtant réellement ensemble, unis, dans leurs plus simples appareils, comme on dit. Ces évocations fantomatiques s’accompagnent d’un agréable vrombissement aux modulations planantes, venant compléter l’hallucination. Comme si, dans ces instants de solitude accompagnée, il entendait le son de son intériorité à elle, en même temps que le vrombissement de son espace interne, tel qu’il se mettait à ronronner quand il se trouvait en elle, habité par elle. Mais que ce soit clair, il n’évoque pas les soupirs, gémissements, halètements et onomatopées qui accompagnent les ébats ; il accède, sans doute, en effet, par le biais des émotions érotiques, au son intérieur de la femme aimée, enfin de celle-làen particulier, comme si ses sens envoyés et télescopés en elle étaient des micros et captaient et amplifiaient l’harmonique qu’elle produit ou plus exactement que produisent les flux qui traversent son organisme, en réponse à tout ce qui se connecte à elle et la situe interactivement dans la biosphère ; de même, il sait qu’elle a capté en lui le même phénomène acoustique. Et qu’elle l’a incorporé au sien. Pas la peine de visionner des scènes de bruiteurs sadiques où il aurait introduit par différents orifices de bons micros allant officier au cœur des entrailles, ils n’en ramèneraient que borborygmes intestinaux, vaginaux, stomacaux, non, imaginez des micros plus psychiques, passant outre ces parois et organes. Le bruit qui flue et fuse tout au fond, en un point abyssal, abstrait et biochimique à fois, où s’organise son métabolisme et qui en maintient la persistance fonctionnelle. Imperceptibles frictions entre particules, selon un rythme strictement singulier, quelques notes personnelles à nulle autre pareilles et moteur de la régulation de l’être dans son identité insaisissable (et qui n’a rien à voir avec l’instrumentalisation politique des « identités culturelles, nationalistes »). Le tatouage sonore que cette femme voyant dans le vide intérieur de l’univers, tel un hologramme cabalistique, la personnalité, le tempérament d’un silence qu’il ne pouvait atteindre que là. Dans la cessation de tout souffle de sons,ce qui se produit en diverses occurrences, notamment en traversant une exubérance de cris et sucions,il entendit son bruit, comme l’écrit Dolorès Prato. « Un fil de bruit plus fin que le fil que l’on pouvait tirer du cocon de ver à soie, couleur or pâle comme lui. J’étais arrivée si loin, dans un espace muet où seul le silence respirait. Ébahie, j’écoutais ce son ébahi. Le silence devait être ce qu’on n’entend pas, et moi, je l’entendais. Jamais personne ne l’avait entendu sinon ce n’eût pas été le silence. Ce n’est pas rien d’entendre ce qui pour tous les autres au monde n’existe pas. Je restai forcément là, immobile, à écouter. » Alors qu’il ressasse ce silence, ce fil de bruitunique qu’il a entendu dans la chair qui cesse d’être chair – et avec laquelle il a perdu tout contact direct – , ce fil de silence-bruit qui s’est incrusté en lui, qui suscite peut-être une sorte de larme au coin de l’œil mais sans attendrissement particulier, entre deux plats, la serveuse dépose devant lui une large coupe qu’il n’a pas venu venir, qui ne correspond pas à ce qu’il a commandé. Quelques quartiers de pamplemousse rose surmontés d’une glace et d’un granité de litchi. C’est un présent du cuisinier qui a reconnu, attablée, une figure apparue là par intermittence, expression d’une fidélité. En partant, échanger un clin d’œil, un sourire, une salutation, un « à la prochaine fois » implicite.
Après une longue averse de neige, il sort au jardin pour colporter de la matière neige fraîche, poudreuse, la mettre en interaction avec son organisme, via le toucher, des gestes, des outils qui brossent et déplacent. Immergé dans le blanc silencieux ouateux qui recouvre et dessine toutes les branches, la moindre brindille. Les pas dans la neige, la raclette qui repousse la couche qui cachait la terrasse, pelleter pour dégager les sentiers, une sorte d’amplification de « ce fil de bruit plus fin que le fil du cocon de ver à soie » et qui le relie à son corps à elle qui n’aurait pas manqué de l’entraîner dans un roulé-boulé nu à même cette peau neigeuse froide immaculée, brûlante.
Puis, seul dans la chambre d’hôtel, à défaut de compagnie, il ouvre un nouveau livre et celui-ci reprenant et modifiant les débuts de la civilisation humaine sur terre, les premières organisations sociales, exposant des points de vues qui bouleversent le « récit civilisationnel standard », il est pris par ce sentiment d’entrer dans un nouveau récit, d’apprendre tout ce qui lui manquait jusqu’ici, il a envie de dévorer le bouquin en une nuit, de tout absorber en une fois, pour mieux jouir et mieux conserver l’articulation des idées, la cohérence des arguments. Faire corps avec. Malgré la fatigue, galvanisé par les mots, les phrases, les idées, il ne sait plus s’arrêter. Le récit civilisationnel démarre toujours avec une date presque précise, avec le fait majeure de la domestication des céréales et de l’invention de l’agriculture qui entraîne la sédentarisation, la naissance de l’État, et voici, c’est parti, le progrès ne s’arrêtera plus jusqu’à nous, linéaire, implacable, justifiant de croire en des formes d’organisations sociales actuelles. Et avant que ne s’enclenche cette marche triomphale, il n’y avait que des barbares. « J’entends défendre l’idée que l’ère des États antiques, avec toute la fragilité qui les caractérise, était une époque où il faisait bon être barbare ». Et, restituant les résultats de nombreuses recherches, les siennes et celles d’autres anthropologues, il démontre que les « barbares » avaient déjà des formes de sédentarisation, que les chasseurs-cueilleurs étaient détenteurs d’innombrables savoirs que l’imposition de l’agriculture céréalière allait faire disparaître. Surtout, ils pouvaient bien vivre en travaillant quatre ou cinq heures par jour, sans contrôle central, sans prélèvement de taxe. Le passage à l’agriculture a signifié aussi un labeur beaucoup plus éprouvant. Le récit traditionnel fait croire à un instant magique où l’homme découvre l’agriculture, forme de vie qui allait attirer l’humanité entière, convertir peu à peu tous les chasseurs-cueilleurs. Il semble qu’il n’en a pas été ainsi. L’homme a planté, semé, a inventé une agriculture sauvage et une horticulture légère bien avant les débuts structurés, étatiques, de l’agriculture. L’évolution a été, comme souvent, plus lente, plus complexe, plus mélangée et tâtonnante. Avec des développements dans une direction, puis des hésitations, des reculs, des résistances. Les possibilités de contre-récit qui palpitent dans les pages de ce livre l’exalte. Le portrait pivot du cultivateur comme homme nouveau introduisant une nouvelle stabilité d’existence par sa prévoyance, son anticipation des récoltes, ne tient plus la route dès que l’on s’intéresse à l’histoire profonde. « Le cultivateur était représenté comme un individu de type qualitativement nouveau parce qu’il devait se projeter loin dans le futur chaque fois qu’il préparait un champ pour l’ensemencer, le désherber, puis veiller sur la maturation de se semis, et ce jusqu’au moment espéré de la récolte. Ce qui est faux dans ce récit – et à mon avis radicalement faux – ce n’est pas tant le portrait de l’agriculteur que la caricature du chasseur-cueilleur qu’il implique. Il laisse en effet entendre que ce dernier était une créature imprévoyante et irréfléchie, esclave de ses impulsions, qui parcourait son territoire à l’aveuglette dans l’espoir de tomber sur du gibier ou d’arracher une baie ou un fruit quelconque d’un buisson ou d’un arbre de hasard (« rendement immédiat »). Rien ne saurait être plus éloigné de la vérité. » (p.81) Et de détailler en quoi les chasseurs-cueilleurs opéraient de manière organisée, réfléchie et prévoyante, avec des calendriers, des méthodes et des techniques élaborées, une activité digne de mériter le nom de civilisation. Les multiples nourritures fournies par l’écosystème étaient connues, étudiées, exploitées de façon prévoyante. « Il faut percevoir les ressources d’un territoire à la façon dont le faisait sans doute un chasseur-cueilleur : comme une réserve massive, diversifiée et vivante de poissons, de mollusques, de noix, de fruits, de racines, de tubercules, de racines et de carex comestibles, d’amphibiens, de petits mammifères et de gros gibier. » (p.80)
Ce qui l’excite n’est pas tellement de découvrir la déconstruction d’un récit dominant, mais de constater à quel point les connaissances humaines sont sans cesse en évolution, toujours susceptibles d’être modifiées, d’accéder à de nouveaux indices à interpréter, que rien n’est jamais figé. L’aventure est loin d’être terminée même s’agissant d’expliquer l’évolution de notre espèce. Même s’agissant de faire parler des vestiges « morts », rigides et tout de même, en nombre limité, le cerveau humain échafaude de nouvelles hypothèses, améliore sa compréhension des bribes, et permet de mieux appréhender ce qu’il se passe maintenant. C’est une excitation spirituelle et charnelle semblable à celle qui caractérisait ses périodes amoureuses où l’attirance, le désir, la plongée dans l’autre complexifie le récit de sa propre vie, lui confère de nouvelles facettes. Il sent, grâce à ce livre qui déplace les repères, que le « récit civilisationnel standard » est idéologique et continue à légitimer des formes d’organisation sociale basée sur l’exploitation des ressources naturelles au profit d’un pouvoir central. Pourquoi l’histoire officielle n’a-t-elle pas été plus prudente, respecté le principe que rien n’est jamais aussi linéaire qu’elle le prétend une fois la domestication des plantes et des animaux en marche ? Les raisons sont multiples, mais il y a cette hypothèse, concernant la nature des sociétés avant la naissance de l’État, qui le séduit : « Ces sociétés reposaient en effet sur ce que l’on appelle aujourd’hui des « biens collectifs » ou des « communs » -plantes, animaux et espèces aquatiques sauvages auxquelles toute la communauté avait accès. Il n’existait aucune ressource dominante unique susceptible d’être monopolisée ou contrôlée – et encore moins taxée – par un centre politique. Dans ces régions, les modes de subsistance étaient tellement diversifiés, variables et dépendants d’une ample gamme de temporalités qu’ils défiaient toute forme de comptabilité centralisée. » (p.73) Il s’endormira le livre en mains.
Les œuvres, dans leur office d’initier des liens, fabriquer des liaisons entre notre système synaptique et les synapses de nos proches disparus, éloignés, celles de l’être que nous fûmes nous-mêmes (nos anciennes synapses et leurs traces), celles de tous les autres organismes ou choses nous environnant, s’il les cultive intensément, systématiquement, comme sa raison de vivre, c’est qu’il sait que cela institue une sorte de chasse-cueillette où à tout moment il peut découvrir l’une ou l’autre qui éveillera le genre de liaisons qui, par cascades, réverbérations, embranchements et dérivations multiples, reconduit ses sensations et émotions esthétiques dans les parages de l’extase sauvage qu’il pouvait quelques fois éprouver devant la beauté de cette amoureuse lointaine. Et il sait qu’il peut très bien passer à côté d’une œuvre sans percevoir son potentiel de retrouvailles. Une beauté qui n’était pas purement plastique ni une essence planant au-dessus des contingences, mais qui surgissait dans les échanges, à l’improviste, justement quand ses expressions, ses intonations, ses mimiques, ses teintes lumineuses se liguaient en cocktail qui donnait accès à d’autres réalités, des manières de sentir la multiplicité de la vie qu’il n’avait encore jamais connues. Et singulièrement dans la fusion érotique, quand elle lui faisait certaines choses guidée par son désir de lui qui le désarmait à chaque fois, un don auquel il n’a jamais été préparé, quand elle le prenait et l’enveloppait de partout, fluide et ferme, alors si proche physiquement du moindre de ses organes, à l’intérieur et à l’extérieur, et pourtant, quand il la contemplait alors en pleine action transie, tellement inaccessible, presque une apparition, un être incroyable essayant d’animer un ignorant, de le ramener pleinement à la vie. Ce que cela a fabriqué, ces instants de puissance, outre des souvenirs qui ne cessent de vibrer et d’inspirer de nouvelles interprétations, s’apparente à ce que l’on peut puiser dans le commerce des œuvres qui durent. « Une œuvre qui dure, c’est une œuvre qui n’en finit pas d’induire les hommes à lier, dont la puissance inductrice-liante continue d’irradier, dont la mesure des effets n’est toujours pas achevée et, dans ce triangle de la durée, de l’induction à lier, et de l’extension des effets, ce sont toutes ces coordonnées spinozistes de la puissance qui se trouvent récapitulées. Mais qu’elle dure est aussi, par le fait, le signe d’autre chose, et doublement. D’abord qu’elle a traversé des configurations passionnelles très variées, par-delà l’espace et les générations, donc qu’elle a traversé de la double épreuve de la variation historique et géographique des ingenia, attestant par là qu’elle est capable de les affecter tous, c’est-à-dire qu’elle touche à « la nature une et commune à tous »… » (p.240) Oui, après décantation, ces scènes vécues acquièrent ce statut étrange d’œuvres qui durent, ont-elles du reste réellement existé, ne les confond-il pas avec d’autres, ou plus réalistement, ne sont-elles pas mêlées à d’autres ? Parfois, il ne sait plus car, comme on le dit parfois le plus simplement possible, c’était si beau. Et il constate que se produit en lui, de plus en plus des exemples de perméabilités entre le réel et ce qu’il a rêvé, en bien comme en mal., des ruptures de digues. Ainsi, il y a longtemps, il vivait dans une petite maison pas très hermétique, pas très solide. Un a peu près de maison. Il y a régulièrement fait le rêve qu’en son absence cet abris était visité, cambriolé et que systématiquement on lui volait sa chaîne stéréo. A force, il finissait par connaître la bande du village qui se livrait à ces exactions, sans les dénoncer, en essayant parfois de leur parler. Mais d’autres nuits, la scène de l’effraction revenait, intacte, et il se réveillait angoissé, en sueur, persuadé qu’il y avait quelqu’un dans a maison. Aujourd’hui, il lui arrive d’être persuadé avoir été réellement l’objet de cambriolages répétés. Il lui faut raisonner un certain temps pour se persuader qu’il ne s’agissait que de mauvais rêves insistants.
Ce qu’il a ressenti hier au restaurant, une subtile extase sonore rémanente – conjugaison du lieu, des mouvement des serveuses, les conversations des convives, la saveur des plats, la présence du cuisiner, les souvenirs – le maintient dans la conviction qu’il est irrigué de signes, de signaux d’autres âmes connectées et que ça lui donne une capacité à dire et à faire des choses (ne serait-ce qu’à ses yeux, dans le périmètre limité de son espace vital minimal, privé). Dans ces instants de solitude accompagnée, il entendait le son de son intériorité à elle, en même temps que le vrombissement de son espace interne, tel qu’il se mettait à ronronner quand il se trouvait en elle, habité par elle. Comment raconter, ou rendre simplement audibles, les sons qui caractérisent les âmes, les petites musiques intérieures ? Quand il entre dans une galerie emplie de sons aux origines difficiles à établir. Une sorte de souffle d’orgues silencieux – ce silence juste après ou juste avant le concert des tuyaux – comme on en perçoit en s’avançant dans certaines allées de grandes cathédrales. Au fond de la grande salle blanche est disposé une sorte d’orchestre symbolique. Des socles de hauteurs différentes, des objets-instruments, des micros, des fils. Des vases, des céramiques, des coupes, des amphores. Le genre d’objets dont des spécimens se retrouvent chez tout le monde, dans tout intérieur domestique. Mais ici, rassemblés, en collection. La musique qui emplit la salle vient de toute évidence des micros qui plongent dans l’ouverture des poteries ou disparaissent dans le corps de telle sculpture, telle figurine, telle armoire. A la manière dont peuvent être organisés dans un orchestres les instruments de différentes familles – cordes, cuivres, vents, percussion -, il y a trois groupes d’objets, trois entités, une centrale, une gauche, une à droite. Toute cette réunion est placée sous le titre « les dieux de la maison ». Mais que vont chercher les micros dans les entrailles de ces objets-vestiges sans réel fil conducteur, famille disparate quant aux usages évoqués et aux époques concernées ? Les microphonesamplifient « le ricochet du son ambiant dans les espaces internes des objets, créant ainsi des boucles de rétroaction acoustiques douces, qui nous permettent d’entendre le son inné de chaque objet ». (Feuillet du visiteur) Bon, si c’est le ricochet du son ambiant, ce n’est pas pleinement le son inné de chaque objet, c’est le son inné de l’interaction entre un son ambiant, variable selon le lieu, et les caractéristiques des entrailles d’un objet dont la forme et la surface des parois, le volume de vacuité, le matériau principal de l’objet et son volume extérieur – il peut épouser l’espace intérieur ou en différer considérablement, développer une masse ou des excroissances qui mobilisent plus ou moins l’environnement et conditionne les manières de résonner. Mais c’est donc bien le son propre de chaque objet en activité de résonance, de ricochet. Les objets ont été choisis pour les relations qu’ils entretenaient avec des personnalités bien précises du roman familial. Sculpture virtuelle de ricochets entre l’objet et la personne, ses ondes propres, les échanges via simple contemplation – la vue de certains objets reposent, aident à se poser – ou par usage, gestes, toucher, comme le cas d’un moulin à café, d’une burette d’huile, d’une sorbetière… Des objets, des ricochets, des sons, des souffles ténus qui sont ceux de la patine réelle ou spéculaire qui s’installe du fait du frottement entre objets, personnes, choses, idées. L’entité centrale, face à l’entrée, est celle du père. A gauche celle de la grand-mère, à droite celle de la mère. Disons que, pour l’essentiel, chaque entité regroupe quelques objets fétiches du père, de la mère, de la grand-mère. Des objets qui leur ont appartenu et qui, au moins pour le fils et petit-fils, ont fini par épouser l’âme de leur propriétaire. L’artiste leur a ajouté quelques pièces acquises par lui-même sur différents marchés et brocantes du monde entier et qui lui semblaient, elles aussi, connectées à l’âme des figures familiales. Il ne se contente pas d’installer un dispositif capable d’amplifier l’infime fil de bruit-silence du ricochet en chaque objet. Après étude de ces sons, il écrit une composition. Il la fait exécuter par l’orchestre des objets. En visitant et auscultant cet étrange orchestre, il constate que sur chaque cordon ombilical noir, reliant chaque entité à l’émission centrale et harmonique du son, de petites lumières s’allument par intermittence, alternance, clignotent. Elles indiquent chaque fois de quel objet le son entendu est en train de sortir. Ces ondes inouïes, complètement silencieuses sans appareillage sophistiqué de captation, n’en existent pas moins même quand nous ne les entendons pas. Elles agissent. Elles entretiennent et sont le chant de ce mycélium animiste qui nous relie à chaque chose, à toutes choses. L’artiste puisant dans ces groupes d’objets ce qui ne cesse de le maintenir en contact avec les ondes parentales, les présences tutélaires qui ont veillé sur lui, qui l’ont enveloppé d’influences protectrices et fertilisantes, en les organisant en composition, il sonde et donne forme à sa propre généalogie sonore, il replace les flux mentaux et organiques de son existence dans une famille nourricière très élargie, il isole, module et sculpte les fils de bruits archi fins, les fils de silence-bruits archi sensibles, plus fins que le fil que l’on pouvait tirer du cocon de ver à soie, couleur or pâle comme lui,dont il se constitue en ricochets toujours immanents et en boucle, jamais figés, fils de bruits-silences dont les débuts et les fins se perdent dans la nuit des temps et le silence à venir. Ce genre d’écheveaux est la signature irréductible à quelque identité que ce soit de toutes nos pulsations métaboliques.
Pierre Hemptinne






























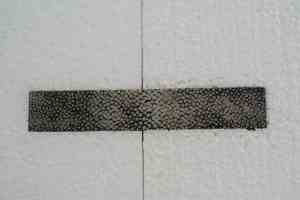





































 Le rendez-vous, la médiation en médiathèque. En rendez-vous du P44 (médiathèque de Bruxelles centre), Alfredo Costa Monteiro parle de son travail, en dialogue avec Yves Poliart, avant d’exécuter une courte démonstration (improvisation). L’occasion d’indiquer à quel point « ces musiques là » (une manière de viser de plus en plus largement les formes musicales, même pas forcément expérimentales, mais où s’expérimente encore et toujours, comme au premier jour, la relation au son, à la construction musicale) manquent et souffrent d’espace de médiatisation et de médiation. Les aspects « bizarres », « surprenants », « incongrus » de ces manières de musiquer – et qui, depuis le temps qu’elles existent et où des pratiques similaires dans les arts plastiques ont été reconnues, ne devraient même plus réellement décontenancer – ainsi expliqués, rendus proches, finalement sont susceptibles d’intéresser beaucoup de monde parce qu’ils réactivent la surprise de la musique, le mystère du son qui raconte, la dimension spirituelle de la vibration sonore: typiquement une mission médiathèque ! Le phénomène. Alfredo Costa Monteiro s’est longtemps cherché à travers un apprentissage académique de la musique, accordéon, guitare, clavier, incluant deux années de Conservatoire. Il y découvre la musique électro-acoustique : une grande salle d’écoute, vingt haut-parleurs, des chaises longues. Là, dans l’obscurité, il se rend compte que la musique peut jaillir sans instruments, par voies indirectes, venir de partout et de nulle part, il en ressent aussi la force narrative et la plasticité. Comme un appel ? Il réoriente son apprentissage vers les beaux-arts. Nouveau terrain d’exploration. Comment communiquer aux matières physiques et malléables les formes de ses musiques intérieures, comment nouer les deux chimies, rendre manifestes leurs connivences, convergences ? Il privilégie déjà les matières dites peu nobles, celles du quotidien, les objets banals que l’on ne remarque même plus, les laissés pour compte du monde. Ces choses qui disparaissent sous leur familiarité : cette familiarité signifiant qu’elles ont absorbé beaucoup de nous-mêmes, de notre vie, pour s’en camoufler, s’y fondre. Il cherche à rendre visible ce qui se cache dans cette familiarité, leurs harmoniques (comme on parle d’harmoniques en musique) et surtout de les laisser s’exprimer. « Leur permettre de penser ce qu’elles n’ont jamais pensé par elles-mêmes ». Il jouera avec la transformation des matières, par exemple du bitume enflammé, sculpture de chaleur, de flammes, fumées, avant d’elle-même stopper sa forme. L’idée d’une combustion que l’on retrouve souvent, plus tard, dans ses créations sonores : décanter l’essence sonore d’une chose, d’une matière, en la chauffant jusqu’à la réduire à son idée, en la cherchant dans ses ultimes retranchements, puis la laisser flamber et enregistrer ses flamboyances. Ce qui, dans la manière de faire, instaure un rapprochement avec l’art plastique : chaque fois qu’il va reproduire par exemple sa pièce « allotropie », ce ne sera jamais exactement la même que la fois précédente, il ira chercher forcément une autre version de l’idée, de l’essence, on se rapproche du principe de « pièce unique » sur lequel fonctionne l’économie des arts plastiques. Et qui s’illustre par l’emballage du CD « allotropie », justement, traits de coupe dans le papier étant différents pour chaque exemplaire. Sa formation hybride (conservatoire, beaux-arts) le conduit à poser des questions hybrides (mais sans doute avait-il au préalable une tournure d’esprit qui l’a poussé vers la formation correspondant au désir de vérifier ses pressentiments) : comment montrer le son dans un musée ? Phénoménologie et distances. Il dit souvent penser et faire la musique selon une approche phénoménologique.
Le rendez-vous, la médiation en médiathèque. En rendez-vous du P44 (médiathèque de Bruxelles centre), Alfredo Costa Monteiro parle de son travail, en dialogue avec Yves Poliart, avant d’exécuter une courte démonstration (improvisation). L’occasion d’indiquer à quel point « ces musiques là » (une manière de viser de plus en plus largement les formes musicales, même pas forcément expérimentales, mais où s’expérimente encore et toujours, comme au premier jour, la relation au son, à la construction musicale) manquent et souffrent d’espace de médiatisation et de médiation. Les aspects « bizarres », « surprenants », « incongrus » de ces manières de musiquer – et qui, depuis le temps qu’elles existent et où des pratiques similaires dans les arts plastiques ont été reconnues, ne devraient même plus réellement décontenancer – ainsi expliqués, rendus proches, finalement sont susceptibles d’intéresser beaucoup de monde parce qu’ils réactivent la surprise de la musique, le mystère du son qui raconte, la dimension spirituelle de la vibration sonore: typiquement une mission médiathèque ! Le phénomène. Alfredo Costa Monteiro s’est longtemps cherché à travers un apprentissage académique de la musique, accordéon, guitare, clavier, incluant deux années de Conservatoire. Il y découvre la musique électro-acoustique : une grande salle d’écoute, vingt haut-parleurs, des chaises longues. Là, dans l’obscurité, il se rend compte que la musique peut jaillir sans instruments, par voies indirectes, venir de partout et de nulle part, il en ressent aussi la force narrative et la plasticité. Comme un appel ? Il réoriente son apprentissage vers les beaux-arts. Nouveau terrain d’exploration. Comment communiquer aux matières physiques et malléables les formes de ses musiques intérieures, comment nouer les deux chimies, rendre manifestes leurs connivences, convergences ? Il privilégie déjà les matières dites peu nobles, celles du quotidien, les objets banals que l’on ne remarque même plus, les laissés pour compte du monde. Ces choses qui disparaissent sous leur familiarité : cette familiarité signifiant qu’elles ont absorbé beaucoup de nous-mêmes, de notre vie, pour s’en camoufler, s’y fondre. Il cherche à rendre visible ce qui se cache dans cette familiarité, leurs harmoniques (comme on parle d’harmoniques en musique) et surtout de les laisser s’exprimer. « Leur permettre de penser ce qu’elles n’ont jamais pensé par elles-mêmes ». Il jouera avec la transformation des matières, par exemple du bitume enflammé, sculpture de chaleur, de flammes, fumées, avant d’elle-même stopper sa forme. L’idée d’une combustion que l’on retrouve souvent, plus tard, dans ses créations sonores : décanter l’essence sonore d’une chose, d’une matière, en la chauffant jusqu’à la réduire à son idée, en la cherchant dans ses ultimes retranchements, puis la laisser flamber et enregistrer ses flamboyances. Ce qui, dans la manière de faire, instaure un rapprochement avec l’art plastique : chaque fois qu’il va reproduire par exemple sa pièce « allotropie », ce ne sera jamais exactement la même que la fois précédente, il ira chercher forcément une autre version de l’idée, de l’essence, on se rapproche du principe de « pièce unique » sur lequel fonctionne l’économie des arts plastiques. Et qui s’illustre par l’emballage du CD « allotropie », justement, traits de coupe dans le papier étant différents pour chaque exemplaire. Sa formation hybride (conservatoire, beaux-arts) le conduit à poser des questions hybrides (mais sans doute avait-il au préalable une tournure d’esprit qui l’a poussé vers la formation correspondant au désir de vérifier ses pressentiments) : comment montrer le son dans un musée ? Phénoménologie et distances. Il dit souvent penser et faire la musique selon une approche phénoménologique. 








 Autres fragments de City Sonics 2009. Piano concrets – J’étais intrigué par l’installation d’
Autres fragments de City Sonics 2009. Piano concrets – J’étais intrigué par l’installation d’

















